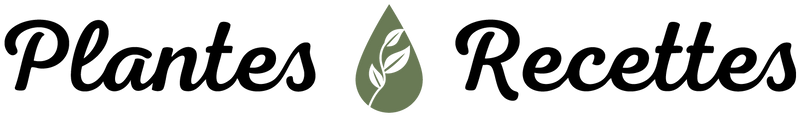Le kéfir fait de plus en plus parler de lui, et pour cause : cette boisson pétillante et naturelle est à la fois délicieuse et bénéfique pour la santé. Fermenté à partir de mystérieux grains de kéfir, il se transmet souvent de main en main entre passionnés. D’où vient le kéfir ? Quels sont ses bienfaits reconnus ? Comment le préparer soi-même, notamment dans sa version sans lait appelée kéfir de fruits ? Découvrez dans cet article complet tout ce qu’il faut savoir sur le kéfir, son histoire, sa fabrication maison pas à pas, et nos conseils pour profiter au mieux de cette boisson vivante.
Qu’est-ce que le kéfir ? Origines et petite histoire
Le kéfir est une boisson fermentée obtenue grâce à des grains de kéfir, qui sont en réalité des agrégats de micro-organismes vivant en symbiose (bactéries et levures) formant une sorte de culture-mère. Ces grains ressemblent à de petites perles gélatineuses, blanchâtres ou translucides selon le milieu de culture. Historiquement, on distingue deux grandes variantes : le kéfir de lait, préparé avec du lait (généralement de vache, brebis ou chèvre), et le kéfir de fruits (aussi appelé kéfir d’eau) préparé dans de l’eau sucrée avec des fruits.
Les origines du kéfir remontent à des siècles. Les grains de kéfir de lait seraient originaires des montagnes du Caucase, où les peuples nomades en consommaient une boisson légèrement alcoolisée réputée pour prolonger la vie. D’après certains récits, le mot kéfir viendrait du turc keyif, qui signifie « plaisir » ou « bien-être », reflétant la joie associée à sa consommation. Longtemps, la fabrication du kéfir de lait fut un secret bien gardé des bergers du Caucase, au point qu’on surnommait les grains de kéfir « graines du prophète » dans des légendes où Mahomet les aurait offertes en cadeau divin.
Ces « grains », composés de bactéries et de levures, transforment le lait en kéfir par fermentation.
Le kéfir de fruits possède quant à lui sa propre histoire. Moins connu traditionnellement que son cousin laitier, il aurait été découvert plus tardivement. On retrouve la trace de boissons fermentées similaires au kéfir de fruits dans différentes régions du monde. Le nom de tibicos est parfois donné aux grains de kéfir d’eau, et certains écrits de la fin du XIX siècle rapportent l’utilisation de ces grains pour fermenter de l’eau sucrée et du jus de figue de barbarie au Mexique. Une théorie plausible est que ces grains se formaient naturellement à la surface des cactus d’Opuntia (figuiers de Barbarie) dans les régions chaudes, où ils pouvaient être récoltés pour ensemencer des boissons sucrées. D’autres histoires situent l’utilisation du kéfir d’eau au Tibet, en Ukraine ou encore dans le sud de la Russie. Quoi qu’il en soit, le kéfir de fruits s’est diffusé mondialement au fil du temps, et il connaît aujourd’hui un renouveau d’intérêt auprès du grand public.
Les bienfaits du kéfir sur la santé
Le kéfir n’est pas qu’une simple boisson rafraîchissante : c’est un véritable aliment probiotique. Les probiotiques sont définis par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) comme des « micro-organismes vivants qui, lorsqu’ils sont ingérés en quantité suffisante, exercent des effets positifs sur la santé, au-delà des effets nutritionnels traditionnels ». À ce titre, le kéfir – riche en bactéries lactiques et en levures bénéfiques – contribue à enrichir et diversifier notre microbiote intestinal, avec de multiples conséquences positives. L’OMS et de nombreuses études reconnaissent l’importance de ces microbes amis pour le bien-être digestif et immunitaire.
En consommant régulièrement du kéfir (de lait comme de fruits), on apporte à son organisme des probiotiques variés (on dénombre plus de 60 souches différentes dans le kéfir). Ceux-ci vont venir coloniser temporairement l’intestin et aider à rééquilibrer la flore intestinale, ce qui améliore la digestion et renforce la barrière naturelle contre les agents pathogènes. Des recherches récentes suggèrent que la prise de kéfir peut soulager certains troubles digestifs : par exemple, des personnes souffrant du syndrome de l’intestin irritable ou de désordres digestifs après une cure d’antibiotiques ont ressenti une amélioration en consommant du kéfir régulièrement. Le kéfir contribuerait à moduler l’inflammation dans l’intestin et à soutenir le système immunitaire via l’action conjointe de ses bactéries et levures probiotiques.
Par ailleurs, le kéfir de lait est une excellente source de nutriments : il contient du calcium, du magnésium, du potassium, et des vitamines (A, D, du groupe B, K) en bonne quantité. Grâce à sa richesse en calcium et en vitamine D, il favorise la santé des os et pourrait aider à prévenir l’ostéoporose. Sa teneur en protéines, conjuguée à son faible apport calorique, en fait un allié intéressant dans le cadre d’une alimentation équilibrée et même pour perdre du poids. Le kéfir de fruits, de son côté, est peu sucré une fois fermenté et offre une alternative saine aux sodas, apportant en plus des antioxydants s’il est préparé avec des fruits riches en vitamines.
En résumé, les principaux bienfaits reconnus du kéfir sont :
• Équilibre du microbiote et digestion facilitée : en apportant de « bonnes bactéries », le kéfir aide à restaurer la flore intestinale, ce qui peut soulager la constipation et améliorer le transit. Il est également connu pour être plus digeste que le lait, car le lactose y est en grande partie pré-digéré par les fermentations.
• Renforcement du système immunitaire : une flore intestinale en bonne santé stimule nos défenses immunitaires. En maintenant l’équilibre du microbiote, le kéfir contribue à protéger l’organisme des infections, notamment via la barrière intestinale.
• Effet anti-inflammatoire : une consommation régulière de kéfir pourrait aider à diminuer l’inflammation intestinale chronique. C’est un facteur de prévention important, car on sait qu’une flore déséquilibrée est liée à un terrain pro-inflammatoire.
• Santé osseuse et apport en nutriments : surtout valable pour le kéfir de lait, qui apporte calcium, phosphore, magnésium et vitamine D favorables à la solidité des os. Un verre de kéfir couvre une part non négligeable de nos besoins quotidiens en calcium.
• Autres effets potentiels : des études explorent l’impact du kéfir sur la régulation de la glycémie et du cholestérol, sur la santé de la peau ou encore comme soutien dans certaines maladies (allergies, troubles métaboliques…). Si les données cliniques sont encore préliminaires, les résultats obtenus chez l’animal ou en laboratoire suggèrent des propriétés antibactériennes, antioxydantes et anticancéreuses intéressantes.
Bien entendu, le kéfir n’est pas une potion miracle à lui seul, et il convient de l’intégrer à une alimentation variée. Mais ses vertus probiotiques en font un atout précieux pour quiconque souhaite prendre soin de sa santé au naturel.
Kéfir de lait vs kéfir de fruits : quelles différences ?
On l’a mentionné, il existe deux types de kéfirs : le kéfir de lait et le kéfir de fruits (ou d’eau). Les deux utilisent des grains de kéfir, mais ceux-ci s’adaptent au milieu dans lequel ils vivent. En réalité, les grains de kéfir de lait et de fruits se ressemblent sans être identiques. Ils contiennent en grande partie les mêmes familles de bactéries lactiques et de levures, organisées en symbiose, mais différentes souches dominent selon le substrat de fermentation. Autrement dit, les micro-organismes du kéfir de lait sont spécialisés pour fermenter le lactose du lait, tandis que ceux du kéfir d’eau sont adaptés pour fermenter le sucre dissous dans l’eau. On considère généralement qu’il vaut mieux utiliser le type de grains approprié à chaque recette (on n’ensemence pas du lait avec des grains habitués à l’eau, et vice-versa), sans quoi la culture peut dépérir au bout de quelques cycles.
Concrètement, le kéfir de lait se prépare en ajoutant les grains dans du lait animal à température ambiante. En 24 à 48 heures, le lait s’épaissit et prend un goût légèrement aigrelet, proche du yogourt à boire, avec une légère effervescence. Les grains, blanchâtres et de consistance ferme (ils ressemblent à du chou-fleur humide), se multiplient et produisent acide lactique, alcool (en très petite quantité, généralement moins de 1%) et gaz carbonique en fermentant le lactose. Le résultat est un lait fermenté pétillant, que l’on peut consommer nature ou agrémenté de fruits, et qui est riche en probiotiques.
De son côté, le kéfir de fruits se réalise dans de l’eau sucrée additionnée de fruits (souvent du citron et des figues sèches dans la recette traditionnelle). Les grains de kéfir d’eau sont translucides, en forme de petits cristaux gélatineux. Placés dans l’eau sucrée, ils consomment le sucre et libèrent là aussi des bactéries lactiques, un peu d’alcool et du gaz carbonique. La boisson obtenue en 1 à 2 jours est assimilable à une sorte de limonade maison probiotique, légèrement acide et peu sucrée. Le kéfir de fruits a l’avantage d’être 100% sans lactose et vegan, ce qui permet à tous de le consommer. En revanche, il n’apporte pas les protéines ni le calcium du lait – c’est vraiment une boisson santé plus qu’un aliment.
En somme, kéfir de lait et kéfir de fruits partagent le même principe de fermentation par une communauté de levures et bactéries (un SCOBY, voir glossaire), mais diffèrent par le goût et la composition : le premier est un breuvage lacté onctueux, l’autre une boisson pétillante aux fruits. Beaucoup de personnes testent les deux et les intègrent différemment dans leur routine : un verre de kéfir de fruits bien frais pour se désaltérer dans la journée, et un bol de kéfir de lait au petit-déjeuner avec des céréales, par exemple. À vous de voir ce qui vous convient !
Préparer son kéfir de fruits maison (recette pas à pas)
Vous souhaitez vous lancer et faire votre propre kéfir de fruits à la maison ? Excellente idée, car c’est facile, économique, et vos grains de kéfir pourront vous resservir indéfiniment si vous en prenez soin. Nous vous proposons ici la recette traditionnelle du kéfir de fruit, avec tous les détails pour bien réussir.
Ingrédients et matériel nécessaires
Pour environ 1,5 L de kéfir de fruits, prévoyez les ingrédients suivants :
• 60 g de grains de kéfir de fruits (soit environ 4 cuillères à soupe bombées).
• 60 g de sucre de canne blond bio (le sucre blond convient bien : moins raffiné que le sucre blanc, il apporte des minéraux appréciés des grains, tout en ayant un goût neutre).
• 3 tranches de citron bio (non traité) d’environ 5 mm d’épaisseur. Le citron apporte une légère acidité qui aide à équilibrer la fermentation et donne du goût.
• 30 g de figues sèches (environ 2 figues sèches moyennes). Les figues nourrissent les micro-organismes du kéfir en leur fournissant des nutriments (minéraux, azote) et contribuent au bon arôme de la boisson.
Côté matériel, munissez-vous de :
• Un grand bocal en verre d’une contenance d’au moins 2 L. Un bocal de type bocal à cornichons ou pot Mason fait très bien l’affaire. Évitez les récipients en métal ou en plastique qui pourraient interagir avec la fermentation.
• Un linge propre ou un couvercle non étanche pour couvrir le bocal lors de la fermentation (un morceau de tissu attaché avec un élastique, ou un couvercle posé sans visser). Le kéfir a besoin de respirer pendant la première fermentation (F1) tout en étant protégé des poussières et insectes.
• Une passoire en plastique ou en inox et un entonnoir, pour filtrer les grains après la fermentation. On conseille d’éviter les passoires métalliques en aluminium ou autres métaux réactifs, car l’acidité pourrait y dissoudre des particules. Une passoire en nylon ou en acier inoxydable convient très bien.
• Des bouteilles en verre solides à fermeture hermétique, type bouteilles de limonade ou bouteilles de kombucha, capables de résister à la pression du gaz. C’est important pour la deuxième fermentation (F2), car le kéfir va pétiller et la pression peut monter. Des bouteilles à bouchon mécanique (avec joint caoutchouc) sont idéales. Prévoyez 2 ou 3 bouteilles de 500 ml ou 1 L.
Avant de débuter, pensez à bien stériliser ou ébouillanter tous vos ustensiles et contenants. Une bonne hygiène évite la contamination de votre kéfir par d’autres microbes indésirables. Lavez-vous aussi soigneusement les mains. Maintenant, passons à la pratique !
Recette étape par étape
1. Mise en route de la fermentation 1 (F1) : dans le bocal en verre, versez environ 1,5 L d’eau à température ambiante (de préférence de l’eau de source ou filtrée ; le chlore de l’eau du robinet peut affaiblir les grains). Dissolvez-y les 60 g de sucre blond en remuant avec une cuillère. Ajoutez ensuite les grains de kéfir de fruits (60 g), les tranches de citron et les figues sèches. Couvrez le bocal avec le linge ou posez le couvercle sans le visser. Laissez fermenter à température ambiante (idéalement entre 20 et 25 °C) à l’abri de la lumière directe. La durée de fermentation idéale est de 24 à 48 heures. Moins vous laissez, plus le kéfir sera doux (sucré) ; plus vous laissez, plus il sera fermenté, acide et pétillant. Ne dépassez pas 3 jours en F1, sous peine d’affamer vos grains et d’obtenir un goût trop vinaigré.
2. Surveillance et signes de fermentation : durant la F1, vous pouvez observer de petites bulles se former dans le bocal, signe que ça fermente ! Les figues sèches, initialement tombées au fond, vont progressivement se réhydrater et peuvent remonter à la surface au bout d’un certain temps, indicateur souvent que la fermentation est bien avancée. Vous pouvez remuer le bocal délicatement une fois par jour pour homogénéiser. Goûtez au bout de 24 h : si le liquide est encore très sucré, laissez encore fermenter. Quand l’équilibre sucre/acide vous convient, passez à l’étape suivante.
3. Filtrage et fin de la F1 : à l’aide de la passoire, filtrez votre kéfir au-dessus d’un saladier ou d’un pichet propre. Les grains de kéfir et les morceaux de fruits resteront dans la passoire. Récupérez les grains (rincez-les éventuellement à l’eau non chlorée si vous allez les stocker, mais ce n’est pas nécessaire si vous enchaînez sur un nouveau batch immédiatement) – on expliquera plus loin comment les conserver ou les réutiliser. Quant aux figues et rondelles de citron, elles peuvent être compostées ou jetées (elles ont transmis tous leurs arômes au kéfir ; certaines personnes aiment toutefois manger les figues fermentées, riches en probiotiques). Vous obtenez environ 1,5 L de kéfir « brut », prêt à être dégusté tel quel ou à subir une seconde fermentation pour plus de pétillant.
4. Mise en bouteille et fermentation 2 (F2) : si vous souhaitez une boisson plus effervescente et éventuellement aromatisée, procédez à la F2. Transvasez le liquide filtré dans vos bouteilles en verre à fermeture hermétique, en les remplissant aux 3/4 environ (laissez de l’espace vide en goulot pour éviter trop de pression). Fermez bien les bouteilles. Laissez-les reposer à température ambiante pendant 24 heures supplémentaires environ. C’est durant cette F2 en bouteille fermée que le gaz carbonique va se retrouver piégé et carbonater la boisson. Attention : la pression peut monter vite, surtout si la température est élevée ou si le kéfir était encore très sucré. Pour éviter tout risque d’explosion, vous pouvez “roter” les bouteilles une fois par jour : ouvrez délicatement le bouchon pour libérer un peu de gaz, puis refermez.
5. Maturation et dégustation : au bout de 1 à 2 jours de F2 (selon le niveau de pétillant désiré), placez les bouteilles de kéfir au réfrigérateur. Le froid va ralentir fortement la fermentation et stabiliser la boisson. On parle de phase de maturation : en quelques jours au frais, le kéfir gagne en finesse de goût. Vous pouvez le consommer dès que c’est bien frais, ou le laisser maturer 1 semaine au frigo, au choix. Servez votre kéfir de fruits maison bien frais, éventuellement avec une rondelle de citron pour la déco. C’est une boisson légèrement acidulée, désaltérante et faiblement alcoolisée (moins de 1° d’alcool). Pensez à ouvrir les bouteilles avec précaution (au-dessus d’un évier par exemple), surtout si elles ont fermenté longtemps, car le contenu est très pétillant. Santé !
Votre kéfir de fruits est prêt à être savouré. N’hésitez pas à ajuster les proportions de sucre ou le temps de fermentation selon vos goûts après quelques essais. Chaque culture de grains étant un peu unique, il faut apprendre à connaître les vôtres et trouver l’équilibre qui vous plaît.
Comprendre la fermentation : levures, bulles et degré d’alcool
Pourquoi le kéfir pétille-t-il ? Le phénomène, naturel, est dû à l’action des levures présentes dans les grains de kéfir. Pendant la fermentation, ces levures consomment le sucre (saccharose) et le transforment en éthanol (alcool) et en gaz carbonique (CO₂). Le gaz ainsi produit forme des bulles, exactement comme dans une bière ou un champagne où ce sont aussi des levures qui travaillent. Durant la première fermentation (F1) en bocal ouvert, le CO₂ s’échappe en grande partie dans l’air. En bouteille fermée (F2), il reste dissous dans le liquide, ce qui crée l’effervescence. De leur côté, les bactéries lactiques du kéfir convertissent une partie du sucre en acides organiques (acide lactique principalement), ce qui acidifie la boisson et lui confère son petit goût aigre. Ce sont ces acides qui, combinés au léger gaz, rappellent la limonade ou le cidre doux.
Il se forme aussi un peu d’alcool durant la fermentation du kéfir, généralement une fraction de degré (0,5% à 1% vol. environ). Ce taux reste très faible – comparable à celui d’un jus de fruit qui aurait fermenté quelques jours – et sans effets notables, sauf si on boit des litres de kéfir. Toutefois, par précaution, il est préférable que les enfants en bas-âge ou les femmes enceintes ne consomment pas de grandes quantités de kéfir sans avis médical, en raison de cette présence d’alcool (aussi minime soit-elle).
Comment contrôler la quantité de bulles dans son kéfir ? Voici quelques astuces :
• La durée de fermentation est un facteur clé : plus vous laissez fermenter longtemps (surtout en F2), plus il y aura de gaz accumulé. Pour un kéfir très peu pétillant, vous pouvez zapper la F2 et consommer juste après la F1 (il sera alors légèrement pétillant, comme du cidre fermé juste avec un linge). Pour un kéfir bien pétillant, faites la F2 pendant 48 h, mais pensez à relâcher un peu la pression chaque jour.
• La température joue également : à chaleur élevée, la fermentation est plus rapide et vigoureuse (donc plus de bulles en moins de temps). En hiver dans une pièce fraîche, le kéfir peut mettre plus de temps et être moins gazeux. Vous pouvez alors prolonger légèrement la F2 ou la faire près d’une source de chaleur douce.
• La teneur en sucre résiduel influe : un kéfir mis en bouteille alors qu’il reste pas mal de sucre donnera plus de gaz (car les levures ont de quoi « manger » et produire du CO₂). Si vous voulez peu de bulles, fermez les bouteilles plutôt quand le kéfir est déjà bien sec (peu sucré) ; à l’inverse, pour plus de bulles, embouteillez un poil plus tôt ou ajoutez une petite cuillère de sucre ou de miel dans chaque bouteille pour alimenter la F2 (technique du priming).
• Enfin, choisissez des bouteilles adaptées et de taille raisonnable : de grandes bouteilles d’1 litre auront plus de volume de gaz à relâcher d’un coup qu’une petite de 330 ml. Dans tous les cas, manipulez prudemment et n’exposez pas vos bouteilles en plein soleil ou près d’une source de chaleur durant la F2.
En suivant ces conseils, vous pourrez ajuster l’effervescence de votre kéfir à votre goût, de légèrement perlant à franchement pétillant. Avec l’expérience, on prend vite le coup de main pour maîtriser la fermentation.
Précautions à prendre lors de la préparation
Préparer du kéfir est facile et sûr, mais il convient de respecter quelques précautions d’hygiène et de sécurité élémentaires :
• Propreté : comme pour toute fermentation, un environnement propre évite les mauvaises surprises. Lavez soigneusement le bocal, les bouteilles et les ustensiles à l’eau chaude savonneuse, rincez bien, et idéalement ébouillantez-les avant usage. Veillez à ce qu’aucun résidu de détergent ou de savon ne subsiste, car cela pourrait nuire aux micro-organismes du kéfir.
• Eau non chlorée : le chlore est un agent antibactérien, donc à éviter absolument pour ne pas tuer les ferments. Utilisez de l’eau de source en bouteille ou de l’eau filtrée. Si vous n’avez que de l’eau du robinet, faites-la bouillir puis refroidir, ou laissez-la reposer 24 h à l’air libre pour que le chlore s’évapore avant de l’utiliser pour votre kéfir.
• Ustensiles appropriés : évitez le contact prolongé des grains ou du liquide acide avec des métaux autres que l’inox. Par exemple, ne laissez pas votre kéfir stagner dans une passoire métallique en aluminium ou dans un récipient en cuivre. Préférez le verre, le plastique alimentaire ou l’inox de qualité. Une cuillère en bois ou en plastique est parfaite pour mélanger.
• Choix des bouteilles : c’est un point crucial. Utilisez toujours des bouteilles prévues pour supporter la pression (bouteilles de bière à bouchon mécanique, bouteilles de limonade, etc.). N’utilisez pas de bouteilles de jus de fruit ou de vin de récupération qui n’ont pas un verre assez épais : elles pourraient éclater sous la pression du CO₂. Ne remplissez pas non plus les bouteilles jusqu’en haut : laissez environ 20% de vide. En cas de doute, effectuez la seconde fermentation dans un bocal fermé avec un barboteur (comme pour la bière) ou placez les bouteilles dans un seau avec un torchon dessus, ce qui contiendrait les débris si l’une d’elles explosait (c’est extrêmement rare en respectant les consignes, mais mieux vaut prévenir).
• Surveiller la fermentation : ne laissez pas un kéfir en F2 traîner des semaines à température ambiante sans « l’ouvrir » de temps en temps. Si vous partez en vacances, stockez les bouteilles au frais avant de partir. En général, le risque principal est la surpression en bouteille : tant que vous y prenez garde, vous ne risquez pas grand-chose d’autre, car le kéfir lui-même empêche le développement de germes pathogènes par son acidité.
En suivant ces bonnes pratiques, vous brasserez votre kéfir en toute sérénité. Rappelez-vous que des grains de kéfir en bonne santé vous le rendront bien : ils fermenteront de façon régulière, sans odeurs désagréables. Un kéfir qui sentirait franchement mauvais ou le moisi indique un problème d’hygiène ou une contamination : dans le doute, jetez tout, nettoyez bien le matériel et repartez sur des bases saines avec de nouveaux grains.
Personnaliser et aromatiser son kéfir de fruits
L’une des joies du kéfir de fruits, c’est qu’on peut le customiser à l’infini avec des saveurs variées. La recette de base citron-figue donne un breuvage délicatement citronné. Mais il est tout à fait possible de retirer le citron et la figue après la première fermentation, puis de parfumer votre kéfir lors de la deuxième fermentation (F2) en y ajoutant d’autres ingrédients. Voici quelques idées d’aromatisation appréciées :
• Au gingembre : le kéfir au gingembre rappelle un peu le ginger ale ou la bière au gingembre (sans alcool). Il suffit d’ajouter quelques rondelles de gingembre frais épluché dans la bouteille pendant la F2, ou d’ajouter une cuillère à café de jus de gingembre frais. Le gingembre apporte une touche épicée et une chaleur agréable en bouche. Vous pouvez combiner gingembre et citron pour une saveur façon ginger beer.
• À la menthe : pour un kéfir tout en fraîcheur, ajoutez 2-3 belles feuilles de menthe fraîche (menthe verte ou menthe poivrée) dans chaque bouteille en F2. La menthe infuse rapidement : 24 h suffisent pour qu’elle libère ses arômes herbacés. Avant de servir, vous pouvez filtrer ou retirer les feuilles. Ce kéfir menthe-citron est excellent servi avec des glaçons, presque comme une limonade à la menthe.
• Au pamplemousse (ou agrumes) : le pamplemousse donne une note acidulée et légèrement amère très rafraîchissante. Ajoutez un quartier de pamplemousse rose (pelé) ou quelques cuillères de jus de pamplemousse dans votre bouteille. On peut aussi utiliser de l’orange ou de la clémentine pour une version plus douce, ou carrément du jus de raisin pour une sorte de kéfir « Champagne » original. Avec les agrumes, attention à ne pas trop prolonger la F2 car leur sucre peut donner beaucoup de gaz rapidement.
Bien sûr, la liste des possibilités est infinie : fruits rouges (framboises, fraises) pour un kéfir rosé, bâton de cannelle et pomme pour un kéfir « tatin », infusion de gingembre-citronnelle, grains de raisin sec, tranche d’ananas, basilic, etc. Laissez libre cours à votre créativité ! Un bon dosage est d’en mettre peu au début (par exemple une petite tranche ou 1 cuillère de l’ingrédient par bouteille), quitte à ajuster par la suite selon l’intensité désirée.
Dernier conseil sur l’aromatisation : introduisez les ingrédients après avoir retiré les grains de kéfir (en F2 donc). N’ajoutez pas de menthe ou de jus sucré en F1 avec les grains, car cela pourrait les perturber ou les abîmer. Les grains préfèrent la recette simple de base. Vous pourrez ainsi réutiliser vos grains pour un prochain kéfir nature, sans les avoir en contact avec des additifs qui pourraient les fragiliser.
Plantes & Recettes propose d’ailleurs des mélanges d’aromates prêts à l’emploi spécialement conçus pour parfumer le kéfir de fruits : n’hésitez pas à les essayer pour varier les plaisirs en toute simplicité.
Où trouver des grains de kéfir ?
La première étape pour débuter, c’est de se procurer les précieux grains de kéfir de fruits. Bonne nouvelle : on n’a pas besoin de les acheter en magasin la plupart du temps, car la tradition veut que ces grains se donnent et se partagent généreusement. En effet, si vous prenez soin de vos grains, ils vont se multiplier au fil des fermentations, vous en aurez donc vite trop par rapport à vos besoins. La communauté kéfir est donc très portée sur l’échange.
Plusieurs options s’offrent à vous :
• Faire le tour de votre entourage (famille, amis) pour demander si quelqu’un a des grains en trop. Vous seriez surpris de découvrir qu’un collègue ou un voisin élève peut-être du kéfir chez lui sans en parler ! Un petit pot de grains fait un heureux et permet de transmettre la culture.
• Rejoindre des groupes d’échange en ligne. Sur les réseaux sociaux (Facebook notamment) ou sur des forums dédiés aux boissons fermentées, on trouve des membres proposant des dons de grains de kéfir, souvent contre remboursement des frais de port si un envoi postal est nécessaire. En France, il existe des groupes « Donne grains de kéfir » très actifs. Le site Troc’Kefir et d’autres plateformes communautaires mettent en relation ceux qui cherchent et ceux qui offrent. Ces échanges sont généralement gratuits ou symboliques.
• Passer par des boutiques spécialisées. Certaines épiceries bio, magasins de produits naturels ou sites web proposent des grains de kéfir déshydratés ou frais. Cette solution peut être pratique si vous ne trouvez pas de don. Veillez à ce que les grains soient de bonne qualité, idéalement issus de culture bio. Sur Plantes & Recettes, nous proposons parfois des grains de kéfir à donner – n’hésitez pas à vous renseigner si cela vous intéresse.
Obtenir les grains est souvent l’occasion d’un échange convivial. Une fois que vous en aurez, à vous de faire perdurer la chaîne : quand votre kéfir aura bien prospéré, pensez à donner vos excédents de grains autour de vous à votre tour !
Conserver et entretenir ses grains de kéfir
Les grains de kéfir sont des êtres vivants (un écosystème de levures et de bactéries). À ce titre, ils demandent un minimum d’attention pour rester en bonne santé, surtout si vous faites une pause dans la production de kéfir. Voici comment conserver vos grains entre deux utilisations :
• Au réfrigérateur (courte à moyenne durée) : c’est la méthode la plus simple. Placez vos grains de kéfir rincés dans un bocal propre, ajoutez de l’eau fraîche et une cuillère à café de sucre (pour les nourrir pendant le stockage), et fermez le couvercle. Entreposez le bocal au frigo, où le froid va endormir les grains et ralentir fortement leur activité. Ainsi « en pause », ils peuvent se conserver 2 à 3 semaines sans problème. Si vous comptez les garder plus longtemps, il est conseillé de changer l’eau sucrée et de rincer les grains toutes les 2 semaines environ pour leur apporter de nouveaux sucres et éviter les moisissures. Cette méthode est idéale si, par exemple, vous partez en vacances ou si vous ne voulez faire du kéfir qu’occasionnellement.
• Au congélateur (longue durée) : les grains de kéfir supportent assez bien la congélation, même s’il peut y avoir une petite perte d’efficacité à la relance. Pour congeler, rincez délicatement les grains à l’eau claire, égouttez-les, puis placez-les dans un petit sachet congélation ou une boîte hermétique. Vous pouvez ajouter un peu de sucre pour les enrober (certains conseillent du lait en poudre pour les grains de kéfir de lait, ou du sucre glace pour ceux de fruits, afin de les protéger pendant la congélation). Au congélateur, les grains se conservent plusieurs mois. Pour les réactiver, décongelez doucement au frigo puis remettez-les dans de l’eau sucrée à température ambiante ; il leur faudra 1 ou 2 cycles de fermentation pour retrouver toute leur vitalité.
• Sécher les grains (très longue durée) : c’est une méthode de sauvegarde traditionnelle. Sur une assiette propre, étalez vos grains rincés et laissez-les sécher à l’air libre, à l’abri du soleil, pendant quelques jours. Ils vont devenir durs et jaunâtres, totalement inactifs. Stockez-les ensuite dans un bocal fermé ou un sac en papier, dans un endroit sec et frais. Séchés, les grains peuvent se conserver jusqu’à un an. Pour les réutiliser, il faudra les réhydrater doucement dans de l’eau sucrée pendant quelques jours, en changeant l’eau chaque jour, jusqu’à ce qu’ils redeviennent moelleux et recommencent à fermenter normalement.
Quelle que soit la méthode, souvenez-vous que vos grains de kéfir sont un peu comme des « pets ». Plus vous les chouchoutez, plus ils vous donneront un bon kéfir. Ne les laissez pas trop longtemps sans sucre (leur nourriture) ni dans des conditions extrêmes. Si vous constatez qu’ils ne fermentent plus bien (par exemple, votre kéfir ne pétille plus ou met trop de temps), c’est peut-être qu’ils ont besoin d’être « réveillés » ou nourris : faites 1 ou 2 fermentations dans du jus de raisin ou ajoutez une demi-cuillère de mélasse dans l’eau sucrée pour un apport en minéraux.
Enfin, gardez toujours une petite réserve de grains en backup (au congélateur ou séchés) au cas où vos grains actifs auraient un problème. Ainsi, vous pourrez repartir de cette réserve. Mais rassurez-vous, avec un minimum de soins, les grains de kéfir sont très résistants et peuvent se transmettre de génération en génération.
En résumé, le kéfir est une boisson vivante, saine et joyeuse à préparer soi-même. Que vous optiez pour le kéfir de lait onctueux ou le kéfir de fruits pétillant, vous profiterez de ses atouts probiotiques et de ses multiples saveurs. N’hésitez plus à franchir le pas : quelques grains échangés, un bocal, un peu de sucre et d’eau, et l’aventure commence. Plantes & Recettes propose d’ailleurs tout le matériel utile pour réaliser votre kéfir maison (bocaux de fermentation, bouteilles à pression, passoires adaptées…) ainsi que des kits d’aromatisation pour varier les goûts sans effort. À vous de jouer, et surtout, bonne dégustation !
Glossaire:
• Fermentation : Processus naturel par lequel des micro-organismes (bactéries, levures) transforment des composés organiques (par ex. le sucre) en d’autres molécules (acides, gaz, alcool). Dans le kéfir, la fermentation lactique et alcoolique produit une boisson acidulée et pétillante.
• Grains de kéfir : Agrégats gélatineux abritant la culture vivante de kéfir, composés de bactéries et de levures en symbiose. Ils servent de « ferment » pour ensemencer le lait ou l’eau sucrée. Ils ressemblent à de petites grappes translucides (kéfir de fruits) ou blanchâtres (kéfir de lait) et se multiplient au fil des fermentations.
• F1 : Abréviation pour Fermentation 1, ou première fermentation. C’est la phase où l’on met les grains de kéfir dans le liquide (lait ou eau sucrée) pour qu’ils fermentent à l’air libre pendant 24-48h. En F1, on obtient un kéfir jeune, non gazéifié, prêt à boire tel quel ou à mettre en bouteille pour F2.
• F2 : Abréviation pour Fermentation 2, ou seconde fermentation. C’est la phase où l’on transvase le kéfir filtré en bouteilles hermétiques pour le refermenter pendant 1-2 jours supplémentaires. La F2 sert principalement à développer l’effervescence (CO₂ emprisonné) et à aromatiser le kéfir.
• Maturation : Phase de repos du kéfir après fermentation, le plus souvent au frais. Pendant la maturation (de quelques jours à une semaine au réfrigérateur), les saveurs du kéfir s’affinent, l’effervescence se stabilise et la boisson gagne en rondeur. On parle aussi de garde au froid.
• SCOBY : Acronyme anglais de Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast, soit « culture symbiotique de bactéries et de levures ». Ce terme désigne toute communauté de micro-organismes vivant ensemble pour fermenter un substrat. Les grains de kéfir sont un SCOBY, tout comme la « mère » de kombucha en est un autre exemple. Ici, bactéries lactiques et levures cohabitent dans une matrice de polysaccharides pour créer le kéfir. Bonne fermentation à tous !