Lorsqu’on suit une chimiothérapie, on pense rarement que des plantes médicinales pourtant « naturelles » peuvent perturber le traitement. Certes, les plantes peuvent être de précieuses alliées pour la santé et renferment des molécules actives puissantes. Cependant, ces mêmes composés risquent d’interagir avec les médicaments de chimiothérapie et la médecine conventionnelle. Beaucoup de personnes débutant un traitement anticancéreux ne savent pas que certaines herbes, compléments ou même aliments naturels peuvent modifier l’efficacité des traitements ou aggraver leurs effets secondaires. Souvent, ces plantes ont une action circulatoire (fluidifiant du sang) ou hormonale (effet “hormone-like”) qui va à l’encontre des objectifs de la chimio. Par exemple, on évitera tout ce qui favorise la coagulation sanguine ou imite les hormones si le cancer est hormono-dépendant, car la chimiothérapie cherche au contraire à éviter ces effets.
Afin de préserver l’efficacité et la sécurité des traitements anticancéreux, voici notre sélection de 10 plantes (et produits naturels) à éviter pendant une chimiothérapie, avec l’explication de pourquoi elles posent problème.
1. Ail (Allium sativum)
L’ail est réputé pour stimuler l’immunité et améliorer la circulation sanguine, mais en cas de chimiothérapie il convient d’être prudent. En effet, l’ail fluidifie le sang en inhibant partiellement la coagulation. Cela peut augmenter le risque de saignements, surtout si la chimio fait déjà baisser le nombre de plaquettes sanguines. De plus, l’ail peut interagir avec le métabolisme de certains agents anticancéreux : des études suggèrent qu’en dose élevée, l’ail risque d’affaiblir l’efficacité de certains traitements (par exemple le tamoxifène, utilisé dans le cancer du sein) tout en renforçant la toxicité d’autres (comme le docétaxel ou la cyclophosphamide). Autrement dit, consommer beaucoup d’ail ou des compléments d’ail pendant la chimio pourrait diminuer l’effet désiré du traitement ou au contraire amplifier ses effets secondaires. Par précaution, il est donc recommandé d’éviter les compléments à base d’ail durant la chimiothérapie. Une consommation modérée d’ail frais dans l’alimentation courante est généralement sans danger, mais informez toujours votre médecin si vous en consommez de grandes quantités ou sous forme concentrée.
2. Ginkgo biloba
Le ginkgo biloba est une plante connue pour améliorer la mémoire et la micro-circulation. Néanmoins, en cours de traitement anti-cancer, son usage est déconseillé. D’une part, le ginkgo a un effet anticoagulant modéré : il peut ralentir la coagulation et donc favoriser des hémorragies (bleus, saignements), ce qui est problématique avec certains protocoles de chimio ou interventions chirurgicales. D’autre part, le ginkgo est très riche en antioxydants, ce qui peut interférer avec l’efficacité des traitements. Certaines chimiothérapies et surtout la radiothérapie agissent en générant du stress oxydatif pour détruire les cellules cancéreuses ; or les composés du ginkgo pourraient atténuer ce mécanisme et donc réduire l’efficacité du traitement. En parallèle, des données indiquent que le ginkgo pourrait accroître la toxicité de certaines molécules de chimio (on l’a observé avec la dacarbazine, les taxanes et d’autres) en perturbant leur métabolisme. Enfin, le ginkgo est à proscrire avant une opération à cause du risque de saignement accru. Pour toutes ces raisons, il vaut mieux s’abstenir de prendre du ginkgo biloba (sous forme de gélules, extraits, tisanes concentrées, etc.) pendant la chimiothérapie, sauf avis médical contraire.
3. Échinacée (Echinacea spp.)
L’échinacée est un remède de phytothérapie bien connu pour ses propriétés immunostimulantes – on l’utilise souvent pour prévenir les rhumes ou stimuler les défenses. Cependant, pendant une chimiothérapie, son usage n’est généralement pas recommandé. D’abord, stimuler le système immunitaire de manière non contrôlée n’est pas forcément souhaitable quand celui-ci est affaibli par la chimio : le traitement pourrait rendre l’organisme plus vulnérable, et une stimulation inappropriée du système immunitaire par l’échinacée peut théoriquement provoquer des réactions indésirables (par exemple un risque accru de réactions auto-immunes ou d’allergies, l’échinacée étant une plante de la famille des Astéracées pouvant provoquer des hypersensibilités). Ensuite, l’échinacée peut interagir avec le foie et les enzymes qui éliminent les médicaments. Certaines recherches suggèrent qu’elle pourrait augmenter les concentrations sanguines de chimiothérapie en inhibant leur dégradation, ce qui accroît la toxicité des traitements. En somme, faute de preuves d’un bénéfice clair en contexte de cancer et au vu des risques potentiels, il est conseillé d’éviter les compléments d’échinacée durant le traitement. Si vous cherchez à soutenir votre immunité pendant la chimio, parlez-en à votre médecin plutôt que de prendre cette plante de votre propre initiative.
4. Ginseng (Panax ginseng, Panax quinquefolius)
Le ginseng (qu’il soit asiatique ou américain) est souvent présenté comme un tonique naturel améliorant la fatigue, l’appétit ou l’immunité, ce qui pourrait sembler utile en cas de cancer. Néanmoins, plusieurs raisons justifient d’éviter le ginseng pendant une chimiothérapie. D’abord, le ginseng possède des molécules à effet “hormone-like” – il contient par exemple des ginsénosides pouvant avoir une activité oestrogénique légère. Ainsi, en cas de cancer hormono-dépendant (comme un cancer du sein sensible aux œstrogènes), le ginseng risque de stimuler la croissance tumorale en mimant l’effet hormonal, ce qui va à l’encontre du traitement anticancéreux. Ensuite, tout comme l’échinacée, le ginseng est un immunostimulant et un adaptogène qui peut interférer avec la chimio : il a été montré qu’il pouvait augmenter la toxicité de certaines chimiothérapies (notamment la dacarbazine, les taxanes ou la cyclophosphamide). Concrètement, cela signifie que la prise de ginseng pourrait amplifier les effets secondaires du traitement (nausées, maux de tête, hypertension, troubles digestifs…) sans augmenter son efficacité sur la tumeur. Par ailleurs, le ginseng peut lui-même provoquer de l’hypertension ou de l’insomnie, ce qui n’est pas souhaitable chez un patient déjà fragilisé. En résumé, évitez le ginseng pendant la chimio, surtout si votre cancer est hormono-dépendant. Si vous souffrez de fatigue ou d’effets secondaires, tournez-vous plutôt vers des solutions validées par votre équipe soignante.
5. Thé vert (Camellia sinensis)
Le thé vert est riche en polyphénols antioxydants (comme l’EGCG) et souvent vanté pour ses effets santé. Pourtant, en cours de chimiothérapie, une consommation élevée de thé vert ou de compléments de thé vert peut poser problème. Le principal risque vient de son pouvoir antioxydant : certaines molécules de chimio (et la radiothérapie) tuent les cellules cancéreuses en produisant des radicaux libres et du stress oxydatif. Boire de grandes quantités de thé vert ou prendre de l’extrait concentré pourrait neutraliser en partie ce stress oxydatif, réduisant ainsi l’efficacité du traitement anti-cancer. Un cas bien documenté est l’interaction entre le thé vert et le bortézomib (un médicament utilisé notamment dans le myélome) : les catéchines du thé inhibent l’action du bortézomib, annulant en partie son effet thérapeutique. En outre, le thé vert peut influencer les enzymes hépatiques et modifier l’absorption de certains médicaments. Cela signifie qu’il pourrait soit diminuer leur action, soit au contraire augmenter leurs effets secondaires en ralentissant leur élimination. Pour toutes ces raisons, il est conseillé d’éviter le thé vert en excès pendant les traitements (y compris sous forme de gélules ou de poudres de matcha concentrées). Une tasse de thé vert de temps en temps ne vous fera sans doute pas de mal, mais par mesure de précaution, limitez-vous à une consommation modérée et espacez-la des prises de médicaments. Si vous adorez le thé, parlez-en à votre oncologue qui vous dira quelle quantité raisonnable vous pouvez boire sans risque d’interaction.
6. Vigne rouge et Marron d’Inde (Vitis vinifera folium, Aesculus hippocastanum)
La vigne rouge (feuilles de vigne rouge) et le marronnier d’Inde sont deux plantes souvent utilisées ensemble pour traiter l’insuffisance veineuse, les jambes lourdes et les varices. Elles ont en effet des propriétés veinotoniques et circulatoires, renforçant les capillaires et améliorant le retour veineux. Cependant, ces effets bénéfiques en temps normal deviennent problématiques en cours de chimiothérapie. En améliorant la circulation sanguine et en fluidifiant légèrement le sang, la vigne rouge et le marron d’Inde peuvent accroître le risque de saignement chez des patients dont la coagulation est fragile (par exemple, si la chimio a fait baisser les plaquettes ou si le patient prend des anticoagulants). Le marron d’Inde contient notamment de l’aescine, qui a un effet anti-inflammatoire vasculaire mais peut aussi potentialiser l’effet des antiagrégants plaquettaires (d’où une contre-indication chez les personnes sous traitement anticoagulant). De même, la vigne rouge est riche en flavonoïdes et antioxydants (proanthocyanidines) proches de ceux du raisin ; ces composés, comme le resvératrol présent dans le raisin, pourraient interagir avec la chimio en réduisant l’effet de certaines molécules (par leur action antioxydante) tout en augmentant la toxicité d’autres (en ralentissant leur dégradation). En pratique, mieux vaut éviter de prendre des tisanes ou compléments de vigne rouge et de marron d’Inde pendant la chimio, sauf avis médical. Cela vaut d’ailleurs pour la plupart des plantes “circulatoires” (petit houx, mélilot, etc.) qui sont déconseillées durant les traitements anticancéreux en raison de leurs effets sur le sang. Si vous suivez un traitement pour un problème veineux, signalez-le à votre médecin afin d’adapter les soins pendant la chimiothérapie.
7. Curcuma (Curcuma longa)
Le curcuma, racine jaune-orangée utilisée comme épice, est plébiscité pour ses vertus anti-inflammatoires et même anticancéreuses préventives (grâce à la curcumine qu’il contient). Néanmoins, en phase de traitement actif du cancer, la prudence est de mise avec cette épice en complément à dose élevée. Des recherches ont montré que le curcuma peut interagir avec les chimiothérapies de plusieurs façons. D’un côté, c’est un antioxydant puissant : comme pour le thé vert, il pourrait théoriquement protéger les cellules cancéreuses du stress oxydatif généré par certains médicaments et ainsi réduire l’efficacité de la chimio ou de la radiothérapie. D’un autre côté, le curcuma a la capacité de potentialiser l’effet de certains agents chimiothérapeutiques, ce qui semble a priori positif mais peut en fait conduire à augmenter leurs effets secondaires toxiques. Par exemple, on a constaté que la curcumine augmente l’action de certains taxanes ou de la dacarbazine, rendant le traitement plus difficile à tolérer (toxicité accrue pour le foie, les nerfs, etc.). En somme, même si le curcuma est souvent cité comme aliment sain, il n’est pas anodin pendant un protocole de chimio. Il est vivement déconseillé de prendre des gélules concentrées de curcuma ou des fortes doses de poudre en automédication pendant le traitement sans avis médical. En tant qu’épice culinaire, de petites quantités dans l’assiette ne poseront probablement pas de problème, mais informez votre équipe soignante si vous consommez du curcuma très régulièrement ou sous forme de complément.
8. Millepertuis (Hypericum perforatum)
Le millepertuis – également appelé Herbe de Saint-Jean – est bien connu pour traiter naturellement l’anxiété et la dépression légère. Mais c’est l’une des plantes les plus dangereuses à associer aux médicaments, et la chimiothérapie ne fait pas exception. En effet, le millepertuis a la particularité d’activer fortement certaines enzymes du foie (notamment le cytochrome P450 3A4 et la P-glycoprotéine) qui sont responsables de la dégradation de nombreux médicaments. Conséquence : si vous prenez du millepertuis, votre foie va éliminer beaucoup plus vite les agents anticancéreux, ce qui réduit drastiquement leur concentration dans le sang et donc leur efficacité thérapeutique. On estime que le millepertuis peut diviser par deux (ou plus) l’effet de certains traitements anticancer – par exemple, il annule en partie l’action du docétaxel, du méthotrexate, de certaines immunothérapies et de nombreux autres médicaments (anticoagulants, antiviraux, contraceptifs…). De plus, le millepertuis peut provoquer divers effets secondaires (nausées, maux de tête, agitation, photosensibilité cutanée), dont on n’a pas besoin en plus des effets de la chimio. Il est donc formellement déconseillé de consommer du millepertuis pendant une chimiothérapie, et même dans les semaines qui encadrent le traitement (son effet enzyme perdure quelque temps après l’arrêt). Cela inclut les tisanes, gélules, extraits liquides ou toute autre forme. Si vous preniez déjà du millepertuis (par exemple pour dépression) avant le diagnostic de cancer, mentionnez-le immédiatement à votre médecin pour trouver une alternative, car il faut généralement arrêter le millepertuis afin de suivre la chimiothérapie dans de bonnes conditions.
9. Soja et autres phyto-œstrogènes (prudence en cas de cancers hormono-dépendants)
Le soja (Glycine max) est un aliment riche en isoflavones, des composés végétaux qui imitent les œstrogènes dans l’organisme (on parle de phyto-œstrogènes). Dans le cadre d’un cancer hormono-dépendant – typiquement le cancer du sein sensible aux œstrogènes, ou certains cancers de l’utérus et de la prostate – la consommation excessive de soja n’est pas recommandée. En effet, ces isoflavones peuvent se fixer sur les récepteurs hormonaux des cellules cancéreuses et stimuler leur prolifération, allant à l’encontre de l’hormonothérapie ou de la chimiothérapie qui visent au contraire à bloquer les signaux hormonaux. Des études épidémiologiques sur le lien soja et cancer du sein ont donné des résultats contrastés, mais par précaution, la plupart des oncologues conseillent d’éviter les compléments alimentaires à base d’isoflavones de soja pendant le traitement. Cela vaut également pour d’autres plantes à phyto-œstrogènes concentrés, comme le trèfle rouge, la sauge, le houblon (présent dans la bière), les graines de lin (linette) ou l’actée à grappes noires : toutes peuvent agir comme de petites doses d’hormones féminines et potentiellement « nourrir » une tumeur hormono-dépendante. Faut-il bannir complètement le soja alimentaire ? Pour les patientes atteintes d’un cancer du sein, les recommandations actuelles tolèrent une consommation modérée de soja sous forme alimentaire naturelle (tofu, yaourt soja, edamame…) – par exemple une à deux portions par jour maximum – car aux doses alimentaires le soja n’a pas montré de risque avéré, et pourrait même avoir un effet protecteur selon certains. En revanche, il faut éviter d’ajouter par-dessus des poudres, laits enrichis, ou gélules très concentrées en isoflavones. En résumé, si votre cancer est hormono-dépendant, soyez prudent(e) avec les aliments ou plantes à effet œstrogénique et discutez-en avec votre médecin ou votre diététicien. Ils vous conseilleront sur ce qui est acceptable dans votre cas particulier.
10. Menthe poivrée (Mentha × piperita) en usage concentré
La menthe poivrée est une plante aromatique apparemment inoffensive, souvent consommée en infusion pour faciliter la digestion ou sous forme d’huile essentielle contre les nausées. En petite quantité dans la cuisine ou en tisane occasionnelle, la menthe ne pose pas de souci majeur même pendant une chimio. Cependant, lorsqu’il s’agit de compléments concentrés ou d’huiles essentielles de menthe, la vigilance est de mise, en particulier pour les patients atteints de cancers hormono-dépendants. L’huile essentielle de menthe poivrée contient des molécules pouvant avoir un effet œstrogène-like léger (bien que différent des isoflavones du soja). Par principe de précaution, les spécialistes en phytothérapie déconseillent l’usage des huiles essentielles à effet hormonal potentiel chez les personnes ayant des antécédents de cancer du sein, de l’utérus ou de la prostate. La menthe poivrée figure ainsi sur certaines listes de plantes à éviter en cas de cancer hormono-dépendant, aux côtés d’autres menthes (menthe verte), de la sauge sclarée, du fenouil ou de l’anis (ces plantes aromatiques ayant des essences pouvant perturber l’équilibre endocrinien). Par ailleurs, la menthe poivrée en complément peut interagir avec des traitements : par exemple, son huile essentielle à dose élevée pourrait gêner l’absorption de certains médicaments ou irriter le système digestif déjà fragilisé par la chimio. En pratique, il est conseillé de ne pas prendre de capsules d’huile essentielle de menthe ou de compléments à base de menthe poivrée pendant la chimiothérapie sans avis médical. Si vous souhaitez utiliser la menthe pour soulager vos nausées ou troubles digestifs induits par la chimio, parlez-en d’abord à votre médecin. Il pourra éventuellement approuver une infusion légère ou proposer d’autres alternatives plus sûres.
En conclusion, “naturel” ne veut pas dire “sans danger”, surtout pendant un traitement aussi lourd qu’une chimiothérapie. De nombreuses plantes contiennent des principes actifs qui peuvent contrarier l’action des médicaments anticancéreux, soit en diminuant leur efficacité, soit en augmentant leurs effets indésirables. Il est donc primordial de signaler à votre oncologue tous les compléments, tisanes ou produits naturels que vous prenez ou envisagez de prendre. Ne restez pas dans le doute : un dialogue ouvert avec votre médecin (de préférence informé en phytothérapie) vous permettra d’éviter les interactions dangereuses. Parfois, après concertation médicale, certaines plantes peuvent être utilisées en accompagnement sécurisé de la chimio pour gérer les effets secondaires, mais cela se fait au cas par cas et sous supervision. En règle générale, si votre médecin n’a pas de connaissances particulières sur les plantes, n’hésitez pas à consulter un phytothérapeute qualifié en lien avec votre oncologue. La priorité absolue doit toujours être la sécurité et l’efficacité de votre protocole anticancer. En optimisant ces précautions et en restant vigilant sur les interactions, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que le traitement se déroule dans les meilleures conditions possibles, sans interférence indésirable due aux plantes. Bon courage dans votre parcours de soins, et prenez soin de vous en faisant des choix éclairés !


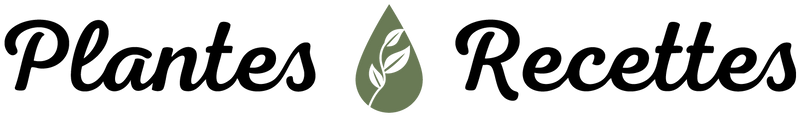









Commentaire
1 comment
Merci, pendant mon cancer je n’ai pas été avertie de tout ça c’est super interessant. Merci